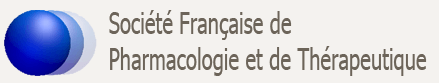#F018 Effets indésirables liés à la supplémentation vitaminique systématique
De quoi parle-t-on ?
Du risque des suppléments vitaminiques notamment dans des produits issus de l’industrie agroalimentaire.
Pourquoi a-t-on choisi d’en parler ?
Le 19 février 2024 un article paru dans Nature Medicine a souligné le rôle délétère des métabolites de la niacine (Vitamine B3) dans l’inflammation endothéliale augmentant le risque cardiovasculaire 1. Cette étude peut donner une explication au résultats décevants des essais cliniques récents de supplémentation et au paradoxe que la baisse du taux de cholestérol-LDL induite par la niacine ne permet pas d'obtenir la réduction attendue des risques de maladies cardiovasculaires 2,3.
L’avis de la SFPT
La supplémentation vitaminique systématique en dehors d’une situation carentielle prouvée semble inutile et potentiellement dangereuse.
En dehors d’indications formelles de supplémentation (pathologies de malabsorption, carences toxiques, sujets à risque, ostéoporose, etc.), il est inutile d’avoir recours à une supplémentation vitaminique. Il semble nécessaire d’insister sur l’importance d’une alimentation variée, équilibrée, à base de produits frais.
Pour approfondir ...#F018 Effets indésirables liés à la supplémentation vitaminique systématique
- Dernière mise à jour le .