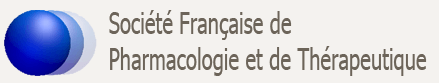De quoi parle-t-on ?
De la publication Cumulative Use of Proton Pump Inhibitors and Risk of Dementia: The Atherosclerosis Risk in Communities Study. (Northuis C, Bell E, Lutsey P, George KM, Gottesman RF, Mosley TH, Whitsel EA, Lakshminarayan K. Neurology. 2023 Aug 9:10.1212/WNL.0000000000207747. doi: 10.1212/WNL.0000000000207747. Epub ahead of print. PMID: 37558503)
par le GT Pharmacoépidémiologie de la SFPT
Pourquoi a-t-on choisi cet article ?
Lorsqu’un médicament fait courir un risque particulier d’effet indésirable, l’importance sanitaire de ce risque s’évalue en termes d’impact.
Pour simplifier, cet impact reflète le nombre de cas d’une maladie dont la survenue aurait théoriquement été provoquée par la prise du médicament, dans le cas d’une relation causale entre prise de médicament et risque de développer une maladie.
Il s’agit d’une mesure théorique calculée sur la base de trois éléments de connaissance. Le premier de ces éléments est l’importance de l’augmentation du risque de développer la maladie lorsque l’on prend le médicament (par exemple, une multiplication par deux de ce risque correspondant à une augmentation de 100 %, ou une augmentation de 20 % correspondant à une multiplication par 1,2). Le second est ce que l’on appelle le risque de base de développer une maladie, qui correspond à la fréquence de survenue « naturelle » de la maladie au cours de la vie en dehors de la prise du médicament étudié. Le dernier est la fréquence de l’utilisation du médicament dans une population. Les deux derniers éléments constituent des déterminants majeurs de l’impact du risque lié à l’utilisation d’un médicament.
De façon synthétique, pour un médicament très peu utilisé, une augmentation très forte du risque de développer une maladie concernant une maladie extrêmement rare aura un impact sanitaire très faible. A l’inverse, pour un médicament très utilisé, une augmentation même très faible du risque de développer une maladie concernant une maladie très fréquente pourra avoir un impact sanitaire considérable.
Or l’étude rapportée dans cet article concerne une classe médicamenteuse extrêmement utilisée en France et dans le monde. Les inhibiteurs de pompe à protons (IPP) sont en effet utilisés chaque année par plus de 15 millions d’utilisateurs en France (dans la moitié des cas sans que l’on puisse identifier un motif de prescription correspondant aux indications reconnues). Elle concerne par ailleurs une maladie très fréquente, la démence, qui est de surcroît une cause majeure de dépendance.
L’existence d’une association sur ce sujet avec suffisamment d’arguments en faveur d’une relation causale nécessiterait de revoir totalement la place des IPP dans la prise en charge des patients, et de ré-évaluer un grand nombre de traitements en cours.
Il était donc indispensable de voir si cette étude est à même d’apporter ce type d’informations, ce d’autant qu’elle a reçu un certain écho dans les médias généralistes.
Rappel : dans l’évaluation d’une étude observationnelle, la question n’est pas de savoir si l’étude démontre une relation causale (elle ne le peut pas) mais si elle met en évidence une relation avec une méthodologie suffisamment forte pour que le caractère causal soit considéré comme très probable.
Ce qu’en pense la SFPT :
Une étude intéressante sur un sujet important, mais qui présente des carences et des incohérences
Il s’agit d’une étude de cohorte de terrain, schéma observationnel solide où tous les individus bénéficient des mêmes conditions de suivi et d’évaluations pour la mesure des caractéristiques de santé, de prise médicamenteuse et de survenue de la maladie. Elle conclue à une augmentation du risque de développer une démence chez les sujets ayant utilisé des IPP pendant plus de 4,4 ans.
Forces et limites de l’étude :
- Le diagnostic de démence fait ici l’objet d’une procédure bien détaillée, identique entre tous les sujets ; il a été validé sans que l’historique de consommation de médicament ait été connu ce qui permet d’éliminer un biais de dépistage. Les deux variables (diagnostic et utilisation médicamenteuse) ont été recueillies prospectivement à l’aide de procédure standardisée, c’est un aspect très important en termes de qualité et niveau de preuve.
- La démence est une maladie dont le développement est lent et débute longtemps avant le diagnostic. Pour ne considérer que des prises médicamenteuses ayant un effet plausible sur son développement, les auteurs ont uniquement relevé les prises médicamenteuses dans la période de 11 ans précédant celle où les nouveaux cas de démence ont été recherchés. C’est un choix correct mais de meilleures options existent. Une période de censure (ou de lag time) dans laquelle on ne prend pas à compte les cinq ou dix années précédant la date de diagnostic aurait été plus robuste. Le fait que l’association n’ait été retrouvée que pour les cumuls d’utilisation les plus importants (plus de 4,4 ans d’utilisation cumulée) compense en partie cette faiblesse puisqu’elle implique que l’utilisation ait débuté au minimum 4,4 ans avant le diagnostic.
- La quantification de la durée d’utilisation des IPP pose question. En cas de visite (ou appel) non réalisé (et donc d’ignorance concernant l’utilisation médicamenteuse à un temps du suivi), les auteurs utilisaient la procédure du last observation carried forward. Celle-ci consiste à reporter à l’identique la mesure précédente, qui pouvait ici dater d’une ou plusieurs années. L’erreur d’évaluation de la durée cumulée d’utilisation est donc potentiellement très importante.
- Des facteurs de confusion potentiels ont été pris en compte tels qu’ils étaient présents en début de suivi. Ceci permet par exemple d’éliminer des analyses l’influence potentielle du sexe, de l’âge, du niveau d’éducation, des antécédents d’hypertension artérielle, de diabète, de la prise d’aspirine ou d’autres médicaments. On regrette cependant que cette recherche de confusion n’ait pas considéré les antécédents de syndrome coronaire aigu (infarctus du myocarde et apparentés) par exemple. C’est une autre limite, d’autant que nous n’avons pas identifié de protocole enregistré au préalable (ce n’est pas une obligation mais il permettrait de connaître les modalités de choix de ces variables d’ajustement).
- Quand on étudie le risque potentiel lié à l’utilisation d’un médicament, on court dans les études pharmaco-épidémiologiques le risque d’un biais spécifique, le biais d’indication. En résumé ici, si l’indication (la raison de la prescription des IPP) est une maladie augmentant le risque de développer une démence, alors les sujets traités par IPP apparaitront à risque augmenté de démence simplement du fait de leur maladie, sans que cela implique un rôle des IPP. Ici encore, une bonne manière d’éliminer ce biais est de comparer le risque de développer une démence chez des sujets traités par IPP et chez des sujets traités par d’autres médicaments avec la même indication. C’est ce que les auteurs ont fait dans leur analyse de sensibilité en utilisant comme comparateurs d’autres médicaments antisécrétoires, les antihistaminiques H2. Et c’est une grande force de l’étude. Or l’association retrouvée initialement disparaît totalement dans ces analyses, ce qui est présenté de manière très contradictoire dans l’article (mention de la disparition puis mention de résultats conservés avec augmentation du risque).
En conclusion, cette étude observationnelle présente des forces certaines mais également une faiblesse importante concernant la mesure cumulée de l’exposition. Il y a en outre une contradiction majeure concernant les analyses de sensibilité telles que présentés dans la section résultats/tableaux et dans la discussion.
 Cette étude n’offre donc pas suffisamment de garanties méthodologiques pour pouvoir envisager une relation causale. Elle ne peut conduire à reconsidérer les prescriptions effectuées dans un cadre dans lequel le bénéfice est évident et a été clairement démontré.
Cette étude n’offre donc pas suffisamment de garanties méthodologiques pour pouvoir envisager une relation causale. Elle ne peut conduire à reconsidérer les prescriptions effectuées dans un cadre dans lequel le bénéfice est évident et a été clairement démontré.
 La SFPT rappelle que c’est avant tout cette question qu’il faut se poser indépendamment de cette étude : toute prescription ne présentant pas de bénéfice avéré est une prescription à risque certain et injustifié (les IPP ont d’autres effets indésirables qui ne font pas débat) et à coût certain et tout aussi injustifié.
La SFPT rappelle que c’est avant tout cette question qu’il faut se poser indépendamment de cette étude : toute prescription ne présentant pas de bénéfice avéré est une prescription à risque certain et injustifié (les IPP ont d’autres effets indésirables qui ne font pas débat) et à coût certain et tout aussi injustifié.