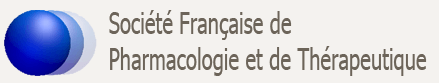Publié dans Covid19-FAQ.
#162 J’entends parler de recherche interventionnelle, non interventionnelle, rétrospective… Qu’est-ce que cela veut dire ?
 Cette vidéo et cette FAQ complètent la FAQ sur l'interprétation des résultats des études cliniques, en se concentrant sur les différents types de protocoles de recherche
Cette vidéo et cette FAQ complètent la FAQ sur l'interprétation des résultats des études cliniques, en se concentrant sur les différents types de protocoles de recherche
La FAQ
Ces recherches doivent recevoir un certain nombre d’autorisations AVANT de débuter.
Dans tous les cas, ces recherches doivent :
- être portées par un promoteur qui en assure la gestion, veille au respect des bonnes pratiques garantissant l’intégrité de l’étude et vérifie que le financement est acquis.
- avoir obtenu l'avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes (CPP)
Les recherches de catégorie 1 nécessitent de plus :
- une autorisation de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) ou respecter une méthodologie de référence (MR001) concernant le traitement des données à caractère personnel des personnes impliquées.
- une autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- la souscription d’une assurance par le promoteur.
- l’information des personnes impliquées dans la recherche et le recueil de leur consentement écrit, qui est libre, éclairé et révocable à tout moment.
Les recherches de catégorie 2 nécessitent de plus :
- une autorisation de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) ou respecter une méthodologie de référence (MR001 ou MR003) concernant le traitement des données à caractère personnel des personnes impliquées.
- Une information de l’ANSM de l’avis rendu par le comité de protection des personnes, sans qu’une autorisation ne soit requise de sa part.
- la souscription d’une assurance par le promoteur.
- l’information des personnes impliquées dans la recherche et le recueil de leur consentement exprès, c’est-à-dire oral, qui est libre, éclairé et révocable à tout moment.
Les recherches de catégorie 3 nécessitent de plus:
- recevoir une autorisation de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) ou respecter une méthodologie de référence (MR001) concernant le traitement des données à caractère personnel des personnes impliquées.
- Une information de l’ANSM de l’avis rendu par le comité de protection des personnes, sans qu’une autorisation ne soit requise de sa part.
- l’information des personnes impliquées dans la recherche et le recueil de leur non opposition à l’utilisation des données recueillies.
En résumé :
|
Recherches interventionnelles |
Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes |
Recherches non interventionnelles |
|
Avis favorable d’un CPP |
||
|
Autorisation de l’ANSM |
Transmission à l’ANSM de l’avis favorable du CPP |
|
|
MR001 ou autorisation CNIL |
MR001 ou MR003 ou autorisation CNIL |
|
|
Assurance nécessaire |
Pas d’assurance |
|
|
Information par l’investigateur |
||
|
Informations résumées dans un document remis au participant |
||
|
Consentement écrit des participants |
Consentement exprès des participants |
Non opposition des participants |
 Toutes ces études sont indispensables pour pouvoir faire avancer les connaissances dans le milieu de la santé et le choix du type d’étude dépend de ce que l’on cherche à démontrer.
Toutes ces études sont indispensables pour pouvoir faire avancer les connaissances dans le milieu de la santé et le choix du type d’étude dépend de ce que l’on cherche à démontrer.
 Nous devons tous nous sentir concernés et accepter ces études pour pouvoir faire bénéficier les générations suivantes.
Nous devons tous nous sentir concernés et accepter ces études pour pouvoir faire bénéficier les générations suivantes.
Les études non-interventionnelles ou observationnelles ou épidémiologiques ont pour objectif d’évaluer les problèmes de santé dans les populations et leurs déterminants. Elles peuvent aussi permettre d’évaluer l’impact d’une intervention en santé en étudiant par exemple l’effet d’un programme de prévention ou de dépistage dans une population.
 On distingue différents types d’études épidémiologiques avec des méthodologies variables selon l’objectif recherché.
On distingue différents types d’études épidémiologiques avec des méthodologies variables selon l’objectif recherché.
- Les études épidémiologiques descriptives ont pour objectif l’étude de la répartition ou l’apparition d’une maladie dans une population. Dans ces études, un seul groupe est étudié, échantillon issue de la population d’intérêt, et si possible représentatif de celle-ci.
- L’état de santé d’une population est décrit par des études transversales afin d’évaluer la prévalence, c’est-à-dire le nombre de personnes touchées par une maladie, dans une population cible. Les données sont recueillies à un instant T, il n’y a pas de suivi. Elles permettent d’établir des relations entre divers paramètres sans pouvoir affirmer qu’il existe une relation causale entre eux.
- L’enregistrement de nouveaux cas de maladie pendant une période est décrit par les études d’incidence. Par exemple, les autorités de santé recueillent chaque hiver les cas de grippe déclarés par des médecins généralistes pour suivre l’épidémie.
On peut comparer la prévalence au volume d’eau contenu dans une baignoire, et l’incidence au débit du robinet remplissant cette baignoire.
Le volume d’eau contenu dans cette baignoire dépend du débit d’eau du robinet : plus le débit est fort, plus la baignoire se remplit vite.
Mais il dépend aussi de la quantité d’eau qui fuit de cette baignoire, qui correspondent aux personnes qui étaient malades mais ne le sont plus, soit parce qu’elles ont guéri, soit parce qu’elles sont décédées. La fuite d’eau est importante si la maladie guérit vite ou si elle est rapidement mortelle, alors qu’elle est faible si la maladie n’est pas mortelle mais non curable (le VIH par exemple).

- Les études épidémiologiques analytiques cherchent à identifier une association entre différents paramètres et les maladies. Elles peuvent être prospectives, c’est-à-dire que l’on recueille les éléments survenant après l’inclusion dans l’étude, rétrospectives, c’est-à-dire que l’on recueille des éléments survenus avant la mise en place de l’étude, ou historiques, c’est-à-dire décidées a posteriori sur des bases constituées de façon prospective (par exemple les bases de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
-
- Les études cas/témoins:
Deux groupes sont constitués en fonction de leur état de santé : un groupe de personnes atteintes de la maladie étudiée, l’autre de personnes indemnes.
Les études cas/témoins comparent ces groupes en recherchant dans les deux groupes l’exposition à un facteur supposé causal.
Comme on étudie une maladie déjà déclarée, ces études sont forcément rétrospectives.
Les deux groupes doivent être comparables, à part pour la maladie étudiée.
Par exemple : on peut chercher le rôle du tabac dans le cancer de la vessie en comparant le pourcentage et l’ancienneté de fumeurs dans la population ayant un cancer et dans une population identique (âge, sexe, profession…) mais indemne.
Ces études ont un faible niveau de preuve, car les résultats dépendent principalement des témoins choisis.
Elles sont utiles lorsque les études de cohorte ne sont pas possibles, pour les maladies rares par exemple. En effet, si on cherche à étudier une maladie ne touchant qu’une personne sur 10000, on aurait trop peu de cas même dans une cohorte de 20000 personnes par exemple pour avoir des données fiables.
-
- Les études de cohorte :
Elles comparent l’incidence, c’est-à-dire la survenue, d’événements bien définis dans deux populations suivies pendant un temps donné, l’une exposée à un facteur et l’autre non.
Les deux groupes doivent être comparables pour limiter les facteurs de confusion (sauf pour l’exposition étudiée).
Elles fournissent un meilleur niveau de preuve que les études cas/témoins, mais elles ne sont pas réalisables pour des événements rares ou retardés car il faudrait une population très importante ou une durée de suivi très prolongée.
Par exemple : on peut étudier la survenue d’une maladie auto immune après la vaccination contre le papillomavirus (HPV) en comparant une population vaccinée à une population non vaccinée.
Parmi ces études, on trouve :
-
-
- Les cohortes prospectives: on étudie la survenue d’une maladie dans deux populations après le début de l’étude. Elles nécessitent un suivi long mais il y a peu de données manquantes grâce au recueil systématique.
Elles ne sont pas réalisables si on veut savoir l’impact de facteurs sur une maladie qui survient après des dizaines d’années.
- Les cohortes prospectives: on étudie la survenue d’une maladie dans deux populations après le début de l’étude. Elles nécessitent un suivi long mais il y a peu de données manquantes grâce au recueil systématique.
-
-
-
- Les cohortes rétrospectives:
On inclut un seul groupe de patient (une cohorte) et on recherche des éléments dans le dossier des patients.
Par exemple, on inclut tous les patients hospitalisés dans un service de réanimation une certaine année et on cherche un lien entre la mortalité et un marqueur biologique.
Il y a souvent des données manquantes, car les données n’ont pas été recueillies dans le but de faire une étude, donc de façon non systématique.
Elles sont utiles pour les maladies qui se déclarent au bout de plusieurs années, où le suivi serait trop long et donc difficile à réaliser en prospectif.
- Les cohortes rétrospectives:
-
-
-
- Les études historiques :
Ce sont les études réalisées sur les bases médico-administratives (base de la sécurité sociale, des instituts de veille sanitaire, etc.).
Ces études sont rétrospectives, car la collecte des données est antérieure à l’étude, mais le recueil systématique et prospectif a permis d’obtenir des données de qualité. Il faut en revanche que ces bases de données contiennent les variables d’intérêt.
- Les études historiques :
-
En résumé
En cas de situation d’urgence qui ne permet pas de recueillir le consentement de la personne, le protocole doit prévoir de solliciter le consentement de la personne de confiance ou des membres de la famille s’ils sont présents.
Une dérogation à cet accord des proches est possible en cas d’urgence vitale immédiate.
Dans les deux cas, il faut :
- Informer dès que possible le participant, les membres de la famille ou la personne de confiance, et demander un consentement de poursuite.
- Informer du droit d’opposition à l’utilisation des données déjà recueillies.
Si le participant ne peut pas donner son accord par écrit (handicap moteur, personne illettrée, …), son consentement oral est suffisant.
Pour les personnes souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou autre trouble cognitif, il revient au tuteur de donner l’accord pour cette recherche.
En résumé :
|
Situation d’urgence |
Situation d’urgence vitale immédiate |
Impossibilité à consentir par écrit |
||
|
Inclusion |
Participant |
Inclusion sans accord préalable |
Inclusion sans accord préalable |
Obtention de l’accord oral |
|
Si proche présent |
Obligation de sollicitation de l’accord |
Pas d’obligation à sollicitation |
Attestation écrite |
|
|
Si proche absent |
Inclusion possible |
Inclusion possible |
Non applicable |
|
|
Poursuite |
Proche |
Information et accord dès que possible |
Information et accord dès que possible |
Non applicable |
|
Participant |
Information et accord dès que possible et apte |
Information et accord dès que possible et apte |
Les recherches sont menées sous la direction d’un investigateur (médecin, professionnels de santé ou personne qualifiée dans le domaine concerné par la recherche) qui doit :
- informer les personnes sollicitées pour participer à une étude sur l’objectif de la recherche, sa méthodologie, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, le droit de refuser de participer et celui de retirer son consentement à tout moment,
- recueillir leur accord de participation à l’étude et s’assurer qu'elles ont bien compris les informations données. Cet accord peut être un consentement (écrit pour les recherches de catégorie 1, « exprès », c’est-à-dire oral, pour les recherches de catégorie 2) ou une non-opposition à l’utilisation des données recueillies (pour les recherches de catégorie 3).
Les recherches interventionnelles (Catégorie 1)
Les recherches interventionnelles impliquent une intervention non dénuée de risque pour les personnes qui y participent, et non justifiée par leur prise en charge habituelle.
Elles concernent les médicaments, des actes chirurgicaux, des dispositifs médicaux, des thérapies cellulaires ou géniques et aussi des produits non médicaux (par exemple des denrées alimentaires).
Les recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes (Catégorie 2)
Les recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes peuvent comporter l’utilisation de produits de santé ou de médicaments dans les conditions habituelles d’utilisation, s’ils ne font pas spécifiquement l’objet de la recherche. On peut y pratiquer des actes peu invasifs (prélèvement veineux sanguins de volume limité, imagerie non invasive…).
Les recherches portant sur un médicament sont exclues des recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes. Toute recherche qui porte sur un médicament est nécessairement une recherche interventionnelle.
Les recherches non interventionnelles (Catégorie 3)
Ce sont les recherches qui ne comportent aucun risque ni contrainte, ne modifient pas la prise en charge des participants et dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle. Elles sont également désignées par les termes « recherches observationnelles ».
Par exemple, elles peuvent porter sur l’observance des traitements, la surveillance d’un médicament après sa mise sur le marché, les pratiques d’un centre de soins comparées à celles d’un autre…
En résumé :
La recherche clinique comprend l’ensemble des études scientifiques réalisées sur l’Homme dans le but de développer les connaissances biologiques ou médicales.
La recherche clinique comprend les essais cliniques, qui évaluent les nouveaux médicaments, mais également des études dont l’objectif est d’identifier les facteurs de risque des maladies, d’évaluer leur pronostic, de comparer des stratégies diagnostiques, etc.
Depuis 2012, la recherche clinique est encadrée par la loi Jardé.
On parle dorénavant de « recherches impliquant la personne humaine (RIPH) », recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales (Article L1121-1 du Code de la Santé Publique).
Ces recherches ont été classées en 3 catégories, en tenant compte de la nature de l'intervention nécessaire à la recherche (si celle-ci modifie ou non la prise en charge habituelle des participants), et du niveau de risque et de contraintes pour les personnes qui acceptent d’y participer. On distingue ainsi 3 catégories
- Recherches interventionnelles
- Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes
- Recherches non interventionnelles
Evaluation de nouveaux traitements
- Dernière mise à jour le .